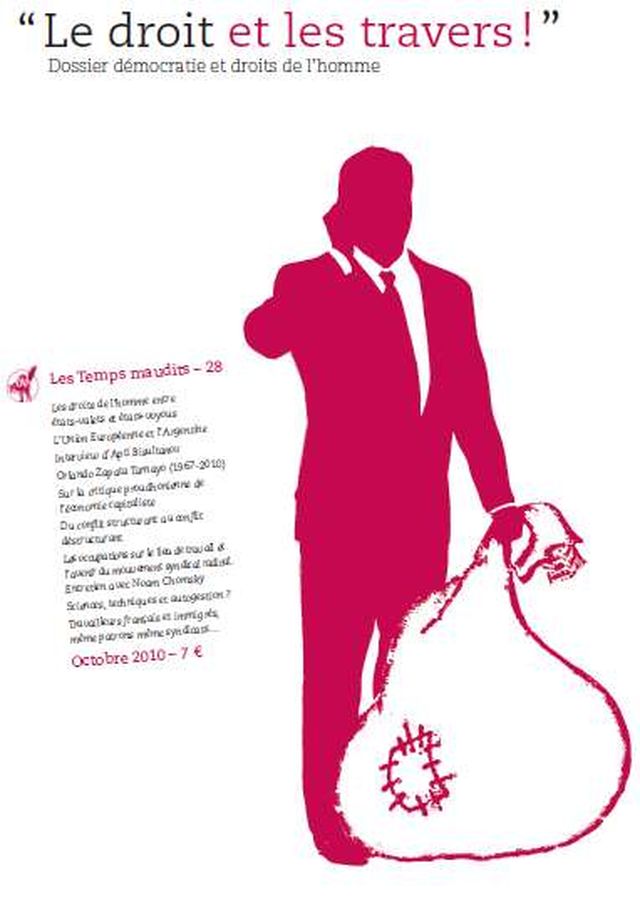 Les Temps maudits n° 28 Octobre 2010 – 128 pages – 7 €
Les Temps maudits n° 28 Octobre 2010 – 128 pages – 7 €
Le numéro 28 de la revue anarchosyndicaliste et syndicaliste révolutionnaire éditée par la Confédération nationale du travail vient de paraître.
En voici le sommaire :
Éditorial
Notre numéro des Temps maudits aborde diverses problématiques liées aux droits de l’Homme. Il nous parait difficile de parler de droits de l’Homme uniquement du point de vue politique et juridique, en escamotant sous un voile impudique les aspects économiques de notre condition d’êtres humains grégaires. C’est pourquoi, en guise de préambule à ce vingt-huitième opus de notre revue, nous aimerions nous interroger sur la légitimité, le droit, de certaines actions syndicales: occupations, séquestrations, saccages de locaux et autres menaces de pollution ou de « faire sauter la taule »…
Dossier « Droits de l’Homme »
« Les droits de l’homme entre États-valets et États-voyous », par Anne Vernet, syndicat CNT Culture Spectacle RP (8 p.)
« Après que le concept d’universalité eut été dénié par un communautarisme qui devint, dès 1992 et la chute de l’URSS, le seul fond de commerce des politiques (démocraties et dictatures confondues), il fallait s’attendre à ce que les droits de l’homme se voient, de session en session du Conseil onusien prétendument chargé de veiller sur eux, réduits à peau de chagrin. Tolérant ça et là le particularisme religieux en référent du droit – et tout aussi empressé de servir partout (et là sans états d’âme) l’universalité du capitalisme – le relativisme culturel s’est érigé en éthique. En conséquence, le droit commercial, coutumier, tend à supplanter les lois civiles. […] Souffrance physique, morale et sociale ; une évidence anthropologique. »
« L’Union Européenne et l’Argentine. Les manipulations des droits de l’homme par les pouvoirs en place », par Frank Mintz, CNT Interco 91 (8 p.)
« L es soutiens venus d’Europe en faveur de tous les organismes des droits de l’homme durant la dernière dictature militaire de 1976-1983 en Argentine constituent un aspect important et encore actuel : des diplomates allemands et italiens ont donné une aide qui sauva la vie de nombreuses personnes ; des journalistes espagnols, hollandais et anglo-saxons ont transmis des informations sur la répression ; des associations hollandaises ont offert des sommes d’argent aux Mères de la place de Mai. En revanche, les gouvernements européens ne dirent rien publiquement contre la dictature… »
« Interview d’Apti Bisultanov », réalisée et traduite par Günter Dobbers et Valentin Tschepego (11 p.)
Nous publions cette interview qui démontre une finesse d’analyse de la Russie actuelle, de l’islam à un état relativement populaire et une absence d’envergure sur d’autres impérialismes présents dans le Caucase. Né en 1953 en Tchétchénie, Apti Bisultanov reçut un prix en 1992 pour son recueil de poèmes sur les victimes tchéchènes de la période stalinienne. Cela peut expliquer son rejet de la politique et sa vision personnelle de l’islam qu’il exprime dans l’entretien.
« Orlando Zapata Tamayo (1967-2010) », par Frank Mintz, CNT Interco 91 (6 p.)
Brève présentation des droits de l’homme à Cuba en deux approches, quelques interrogations et une réponse à vif. Orlando est mort à 42 ans, le 23 février 2010, des suites d’une grève de la faim de quatre-vingt-cinq jours. Il réclamait simplement des conditions de détention semblables à celles dont avait bénéficié Castro lors de son incarcération en 1953. Maçon, plombier, militant des droits de l’Homme, il avait été condamné à trente-six ans d’emprisonnement pour « outrage, désordre public et rébellion ».
« Sur la critique proudhonienne de l’économie capitaliste », par Luc Bonet, CNT Interco Poitiers (12 p.)
« Dans les pays capitalistes avancés, le tiers exclu sur lequel s’est érigé la critique socialiste – on est soit salarié, soit capitaliste, mais pas les deux – n’est pas l’unique ‘problème ’. Il suffit d’évoquer la question du salaire, revenu théoriquement limité à ce qui assure la simple reproduction de la ‘force de travail ’. Qu’en est-il du cadre de direction, de l’ingénieur, de la prof’, du technicien, de l’ouvrière, avec un écart de trois par rapport au salaire moyen ? Et qu’en est-il, par voie de conséquence, de la solidarité de classe et des rapports entre ces salariés dans un syndicat, même en excluant le cadre de direction ? Et l’on pourrait allonger indéfiniment la liste de tout ce qui ne correspond pas dans la réalité aux analyses économiques sur lesquelles on continue de s’appuyer, un siècle et demi après leur élaboration. »
« Du conflit structurant au conflit déstructurant. À propos de la rationalité du conflit », par Philippe Coutant, CNT Interco 44 (20 p.)
« Aborder la question de la rationalité des conflits implique de constater que les conflits sont partout et innombrables. Essayer de classer ces conflits aboutit à se demander quel ordonnancement conceptuel est pertinent. La modélisation a un côté un peu arbitraire et schématique. Mais cette étape de la pensée est nécessaire pour comprendre ce qui est à l’oeuvre et les enjeux. Nous devons admettre que nos conclusions peuvent se lire en termes de tendances, puisque tout ne correspond pas exactement au schéma proposé. Malgré ces difficultés, proposer des hypothèses est nécessaire et c’est l’objet de notre philosophie comme théorie du général… »
« Entretien avec Noam Chomsky », traduit en français par Fabien Delmotte, syndicat CNT des travailleurs et travailleuses de l’Éducation 92 (10 p.)
Les occupations sur le lieu de travail et l’avenir du mouvement syndical radical. Cet entretien a été réalisé par Diane Krauthamer (IWW, Industrial Workers of the World) le 9 octobre 2009, dans le bureau du professeur Noam Chomsky au Massachusetts Institute of Technology, à Cambridge (Massachusetts).
« Sciences, techniques et autogestion ? Autogestion des sciences », par Antonio Martín Bellido, syndicat CNT des industries de l’informatique RP (11 p.)
« La science commence dès le moment où l’Homme prend conscience de son environnement et systématise sa curiosité – produit de son instinct de survie – pour le comprendre et l’expliquer. Cette curiosité innée fonde la science et devrait être toujours présente au coeur de l’activité scientifique. Cet objectif de la science, comprendre et expliquer, s’applique à ce que sont les choses et les phénomènes, ce que nous observons et ce que nous sentons. La technique commence lorsque nous voulons tirer de l’utile de ce savoir ; alors entrent en jeu les intérêts particuliers des Hommes, et inévitablement les polémiques et les affrontements. Mais ce n’est plus de science qu’il s’agit… »
« Travailleurs français et immigrés, même patrons, même syndicats… », par Étienne Deschamps, juriste auprès du syndicat CNT du Nettoyage et Bernard, CNT Santé social RP (10 p.)
De congrès en congrès, la CNT affirme comme priorité l’action en direction des plus précaires et son soutien à la lutte des sans papiers, confirmée par l’engagement de la région parisienne lors de l’occupation de l’église Saint-Bernard. La mobilisation depuis 2008, de plusieurs milliers de travailleurs sans papiers avec comme arme première les syndicats, interroge et nous met face à de nouveaux défis.
Livres et revues
Recensions de parutions récentes
—–
Abonnements à la revue Les Temps maudits (33 € les 6 numéros; soutien: 40 €) :
Bourse du Travail, salle 15bis, 42028, Saint-Étienne Cedex 1, France – Courriel : temps-maudits@cnt-f.org
Chèques à l’ordre de la CNT. Rédaction : Syndicat de l’Éducation CNT, 4 Résidence du Parc, 91120 Palaiseau



